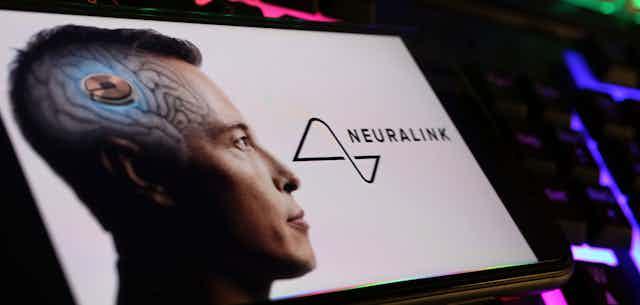Les tenants du transhumanisme nourrissent l’ambition d’améliorer l’être humain afin d’accroître ses performances. Ils œuvrent ce faisant surtout à la création d’un humain en parfaite adéquation avec les logiques du capitalisme. Il est essentiel de poser un regard sociologique critique sur ce mouvement, lequel parait moins accomplir une quelconque évolution, que consacrer un renoncement politique aussi radical que préoccupant.
Ayant pris son essor au début des années 90 aux États-Unis, le transhumanisme désigne un mouvement de pensée influent, rassemblant une diversité d’acteurs, d’entrepreneurs, de chercheurs ou encore de philosophes qui partagent une même ambition : améliorer l’être humain et ses performances physiques, intellectuelles et émotionnelles grâce aux avancées technoscientifiques et biomédicales. L’objectif ultime ? Accéder à un nouveau stade de notre évolution où l’être humain pourrait vivre éternellement, émancipé de toute forme de déterminisme biologique.
Objet d’une véritable fascination, le transhumanisme s’est imposé comme un sujet de société aussi inévitable que controversé. Cristallisant les espoirs, les angoisses, mais aussi les fantasmes de notre époque, il suscite des déclarations toujours plus sensationnalistes.
« Les surhommes qui verront le jour dans les cent ans à venir se différencieront sans doute davantage de nous que nous différons de l’homme de Néandertal ou du chimpanzé », pouvait ainsi affirmer en 2017 l’historien israélien Yuval Noah Harari.
Derrière ces grands discours et les effets d’annonce des entrepreneurs de la Silicon Valley – berceau du mouvement – il apparaît nécessaire d’interroger le sens et la portée sociale et politique des promesses transhumanistes. Sociologue et politologue, professeur d’université (HEC Montréal), je travaille depuis de nombreuses années sur ce mouvement de pensée auquel j’ai consacré trois essais qui défendent une perspective critique invitant à mettre à distance ce que j’ai appelé le « transhumanisme-spectacle ».
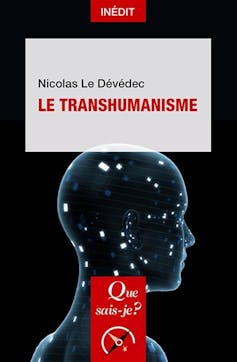
S’il est un risque central posé par le transhumanisme, mes recherches montrent que c’est celui de contribuer à dépolitiser nos imaginaires. Comme je l’aborde dans cet article, l’idéal de l’humain augmenté laisse avant tout entrevoir le futur d’un humain aliéné et adapté au monde capitaliste. Le transhumanisme consacre l’abandon de toute remise en question politique de ce monde et de ses effets délétères sur la planète, l’humain et le vivant, au profit d’une remise en question de l’humain lui-même, appréhendé comme un être inadapté.
Dépasser l’humain, l’humain dépassé ?
« Nous sommes des êtres vivants remarquables, mais ce serait une arrogance anthropocentrique que d’affirmer que nous sommes parfaits. Nous sommes des êtres extraordinaires, mais aussi extraordinairement imparfaits », affirment les représentants de l’association transhumaniste française AFT Technoprog, Didier Coeurnelle et Marc Roux. L’ambition de dépasser la condition humaine qui est constitutive du transhumanisme repose de fait sur une conviction tout aussi solidement ancrée dans l’histoire du mouvement : celle que l’être humain serait un être déficient.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
S’il faut pour les transhumanistes améliorer l’humain, c’est en effet précisément parce qu’il serait défaillant. Le philosophe anglais Max More, l’une des figures pionnières du mouvement, est celui qui a le mieux exprimé cette vision dépréciative de la condition humaine dans sa fameuse Lettre à Mère Nature : « Chère Mère Nature. Sans aucun doute tu y as consacré le meilleur de tes forces. Mais, sans vouloir te manquer de respect, concernant la constitution humaine, tu n’as pas toujours bien travaillé. […] Ce que tu as créé est magnifique, mais pourtant profondément déficient. »
C’est pour corriger cette supposée imperfection originelle de l’être humain que les transhumanistes souhaitent modifier sa « nature » en recourant aux nouvelles technologies.
Il en irait même de la survie de l’espèce humaine. Car, pour les transhumanistes, la déficience de l’être humain redoublerait d’intensité avec l’avènement de nos sociétés modernes, où les rythmes de l’accélération technologique déclassent toujours un peu plus nos corps et nos esprits. L’être humain n’aurait ainsi tout simplement plus d’avenir s’il ne consentait pas à s’optimiser biotechnologiquement : « Si, par un consensus proprement miraculeux, l’espèce humaine tout entière décidait de refuser le progrès, le résultat à long terme serait presque certainement son extinction », déclarait le roboticien autrichien Hans Moravec.
De l’humain obsolète à l’humain up-to-date
Ce grand récit transhumaniste d’un être humain déficient, n’ayant d’autre choix que celui de s’adapter en se modifiant lui-même, concourt à une dépolitisation profonde de nos conditions d’existence.
Partant du principe que c’est l’être humain qui pose problème, ce type de discours contribue à dédouaner la civilisation industrielle capitaliste de toute responsabilité dans la crise politique, sociale et écologique contemporaine. Pour les transhumanistes, ce n’est jamais l’organisation sociale et politique de notre monde qu’il faut remettre en question – en l’occurrence le monde capitaliste et son impératif de croissance et de dépassement de toutes les limites, humaines, vivantes et terrestres – mais l’être humain en chair et en os.
C’est pour rattraper les « progrès » jugés inéluctables de l’intelligence artificielle et parce qu’ils considèrent que nos cerveaux seraient biologiquement désuets que les transhumanistes en appellent ainsi à « augmenter » techniquement nos capacités cognitives. L’entrepreneur Elon Musk, récemment promu par le président américain Donald Trump « ministre de l’Efficacité gouvernementale », a justifié dans ces termes la création de sa compagnie Neuralink, qui vise à mettre au point des implants cérébraux devant permettre, espère-t-il, de rendre nos cerveaux plus efficaces, plus rapides, en somme plus compétitifs.
C’est également pour enrayer la montée des violences à l’échelle mondiale et parce qu’ils considèrent que le problème serait l’archaïsme de notre sens moral – hérité qu’il serait des temps les plus reculés de notre histoire – que les transhumanistes proposent d’augmenter ce dernier artificiellement, notamment par l’usage de la pharmacologie : « Nous suggérerons qu’il n’y a en principe aucune objection philosophique ou morale à l’utilisation de tels moyens biomédicaux de renforcement moral – l’augmentation morale, comme nous l’appellerons », écrivent les chercheurs australien et suédois Julian Savulescu et Ingmar Persson
Rien ne sert non plus pour les transhumanistes d’incriminer notre modèle de société capitaliste face à la crise écologique. La désuétude de nos corps et de nos métabolismes serait ici encore en question. Envisager une bio-ingénierie de l’être humain pour accroître la résistance de nos corps (à des températures extrêmes, par exemple) ou pour les rendre moins polluants, tel serait l’objectif : « Nous appelons ce genre de solution l’ingénierie humaine. Cela implique la modification biomédicale des humains afin de diminuer leur impact sur le changement climatique. »
Les auteurs de cette étude évoquent ainsi l’usage de la pharmacologie pour susciter artificiellement une intolérance à la viande ou encore la réduction génétique de la taille des êtres humains afin de diminuer leur empreinte écologique !
Changer l’être humain ou sortir du capitalisme ?
En appréhendant le transhumanisme sous un angle sociologique et philosophique politique critique, on s’aperçoit en définitive que le risque principal qu’il pose n’est pas tant que ses promesses se réalisent. Il est plutôt qu’elles nous aveuglent et nous détournent de l’essentiel : l’urgence politique, sociale et écologique de changer notre rapport au monde. « Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être bien adapté à une société profondément malade » faisait valoir le penseur indien Jiddu Krishnamurti. C’est pourtant bien cela que défendent in fine les transhumanistes.
Notre modèle de société capitaliste – fondé sur la croissance exponentielle – est littéralement intenable, les rythmes de l’accélération sont invivables ? Qu’importe, répondent-ils, augmentons l’humain et ses performances ! Remettons-le à niveau, accélérons son corps et son esprit !
Le transhumanisme constitue de ce point de vue tout sauf une révolution. Il est précisément le contraire : une formidable machine à dépolitiser et à légitimer le système.
Or, l’impératif qui est le nôtre n’est pas de modifier l’être humain pour l’adapter au système. Il est tout au contraire, ainsi que nous y invitent les courants de la décroissance, de l’écologie politique et de l’écoféminisme, de remettre radicalement en question ce modèle de société inhumain et écocidaire.
Bifurquer, en changeant de trajectoire politique et en instaurant une tout autre relation au vivant, ou bien s’adapter, à grand renfort de technologies et d’ingénierie de l’humain pour survivre aux conditions de vie toujours plus dégradées du capitalocène, tel est le choix de société décisif devant lequel nous sommes aujourd’hui placés.