À la suite de son assermentation comme 47e président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump a rapidement altéré les termes de la conversation du pays, clame-t-on sur bien des tribunes. C’est ce point de vue que reprenait il y a peu l’historien américain Timothy Naftali, professeur à l’Université de New York.
L’assertion du spécialiste est-elle aussi juste et précise qu’il y paraît ?
On ne peut évidemment minimiser l’impact qu’aura le nouveau locataire de la Maison-Blanche sur l’évolution des États-Unis, voire sur celle du monde. Son désir est de passer à l’Histoire comme redresseur de l’Amérique et sauveur de l’humanité. À cet effet, il entend reconfigurer la nation américaine suivant son programme, qu’il croit légitime et heureux à défaut d’être légal et vertueux.
Pour parvenir à ses fins, Trump — ne nous méprenons pas — n’entend nullement sortir de la conversation nationale, pas plus qu’il ne désire rompre avec le lexique de son pays. C’est le contraire qui est vrai. Depuis son entrée en politique, l’homme à la crinière dorée exploite à sa guise certains mots clés de la nation américaine, ceux par lesquels cette nation s’est historisée dans le temps et qui, en retour, l’ont consolidée comme communauté nationale, d’hier à aujourd’hui.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Les mots constitutifs de la nation américaine
Professeurs à l’Université Laval et auteurs de plusieurs publications sur les identités nationales, nous nous penchons depuis longtemps sur la production, la transmission et l’assimilation des représentations de la nation dans la société, y compris par la voie lexicale.
Une recherche de notre cru, bientôt en librairie, nous permet d’éclairer le discours de Trump et de saisir les fondements et filaments de sa rhétorique.
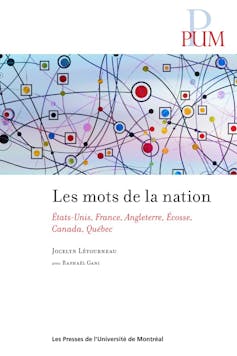
Forts des méthodes de l’histoire culturelle et de la sociolinguistique, nous avons, à partir d’un corpus de quelque 930 énoncés produits par des Américains de toutes conditions et de tous milieux, entrepris d’identifier le répertoire des mots clés formant le lexique de base des États-Unis.
Bien que ces mots relèvent de l’expression ordinaire et routinière des personnes interrogées, ils n’ont rien de trivial. Au contraire, ces mots amènent la nation américaine à se reproduire sous l’angle d’une communauté imaginée de communication, et ce, à travers un processus ressortissant du nationalisme banal.
Sur la base de corpus comparables en nature et en volume, nous avons effectué le même exercice dans le cas de cinq autres nations : la France, l’Angleterre, l’Écosse, le Canada et le Québec. Chaque nation présente une configuration lexicale spécifique.
Parmi les mots clés de la nation américaine figure bien sûr freedom, terme central à la constellation lexicale du pays. Mais on y trouve aussi God, de même que strong, great, fight, war, progress, win, bad, hardworking, prosperity, greed, powerful, et d’autres encore.
Or, à l’occasion des trois dernières élections — celles de 2016, de 2020 et de 2024 —, Trump a largement employé ces mots, qui résonnent fortement dans la conscience populaire américaine. Il les a utilisés pour se mettre en scène, présenter son programme, décrire ses adversaires (tous crooked, bad ou greed à ses yeux), mobiliser sa base et s’adresser à la nation dans son ensemble.
Read more: La victoire de Donald Trump est celle de l’extrémisme. Le centre ne tient plus
Donald Trump et la rhétorique des mots clés
Des exemples de l’usage des mots clés américains par le nouveau président ?
On se souvient du terme qu’il a prononcé trois fois après avoir été touché à l’oreille par le projectile d’un tireur éperdu en Pennsylvanie — fight, fight, fight —, formule qu’il a reprise dans un mème viral pour promouvoir sa cryptomanie personnelle, le $Trump.
On se rappelle aussi ses allusions aux valeurs fondamentales de la nation américaine, à celle du travail acharné notamment (hardworking), dont il se dit le prototype incarné, avec son alter ego Elon Musk, véritable stakhanoviste et adepte de la liberté à tout prix, quitte à enfreindre les lois.
On se souvient encore de sa répétition immodérée du terme prosperity, qu’il ramènera promptement aux États-Unis, affirme-t-il, parce qu’il est né gagnant et programmé pour le rester. (Trump sait que les Américains ont besoin d’un leader qui leur promet la victoire).
Qui a oublié ses incantations à God, bible en main et l’air grave, après avoir repoussé la foule qui l’importunait par ses remontrances, devant la St. John’s Episcopal Church, à Washington, D.C., le 1er juin 2020 ?

Et qui peut méconnaître ses appels chroniques à la puissance infinie de son pays (strong, great, powerful), qu’il entend utiliser à son gré pour atteindre son but ultime : rendre à l’Amérique sa grandeur, peu importe la façon d’y parvenir, par la force économique ou l’agression armée (war), et quel que soit le statut de ses interlocuteurs, ennemis ou alliés ?
Le verbe national américain
Les mots utilisés par Trump ne sont pas des termes spécifiques au mouvement MAGA (Make America Great Again). Il s’agit de vocables propres au lexique national américain, qu’il reprend à son compte et réinvestit de ses significations, intentions et ambitions. Depuis dix ans, le guerrier solitaire, comme il s’auto-proclame en s’appropriant une légende sioux, camoufle ses velléités personnelles dans le discours accrédité de la nation américaine, qu’il récupère et dramatise à ses fins.
L’idée n’est pas d’avancer que les victoires de Trump tiennent à sa mainmise sur le lexique national des États-Unis. On ne peut toutefois négliger ce facteur parmi les raisons qui l’ont amené au pinacle du pouvoir.
Les mots comptent. Il ne s’agit pas de simples supports de communication, mais de repères mis en langage, voire de vecteurs de culture, qui échappent à leur stricte valeur d’usage pour devenir des embrayeurs de mobilisation et d’affiliation populaires. Les nations se forment également autour de mots (p)référentiels que les gens connaissent, dans lesquels ils se reconnaissent et par lesquels ils se sentent convoqués, voire transportés.
Lexique trumpiste, lexique états-unien
Trump n’a pas altéré les termes de la conversation américaine, si par altéré on entend qu’il a transformé son système référentiel et changé le registre lexical de la nation. Il s’est plutôt adjugé ce système référentiel et ce lexique national, qu’il conjugue au temps du trumpisme. En témoigne l’exemple ci-dessous, où l’effigie du président en devenir remplace celle de Benjamin Franklin, père fondateur du pays, et où l’aphorisme imprimé sur le billet pastiche se lit « In Trump We Trust » plutôt qu’« In God We Trust », devise officielle des États-Unis depuis 1956.

Read more: Ego, orgueil et narcissisme : la place de Donald Trump parmi les 45 autres présidents américains
Ceux qui déconsidèrent l’occupant principal du 1 600, Pennsylvania Avenue diront bien sûr qu’il pervertit les termes centraux du vocabulaire américain, qu’il en fausse les définitions et en salit les significations. Les adeptes et sympathisants du président affirmeront de leur côté qu’il redonne de la teneur, de la valeur et de la vigueur aux mots clés du pays, et qu’en les employant à sa manière, qui est selon eux la « bonne » manière, il replace les États-Unis à l’endroit, sur leur piédestal naturel.
Dans les deux cas, les mots sont les mêmes ; seules changent leur utilisation, définition et affectation.
Perdurances lexicales
Les nations sont rétives à modifier l’armature de leurs fondements symboliques, parmi lesquels figure un répertoire de mots clés caractérisés. Il est d’ailleurs rarissime que les nations se défassent et se refassent entièrement, même dans la brutalité de leurs métamorphoses politiques ou la violence de l’entreprise révolutionnaire.
Trump n’est pas en porte-à-faux par rapport à la conversation nationale américaine.
Désireux de la purger de ses termes réputés impropres, il se situe plutôt au cœur de cette conversation, d’où l’efficacité de son message, la portée de son influence et la polarisation qu’il génère parmi la population, laquelle s’accorde ou se désaccorde continuellement sur les « mots de la nation ».




